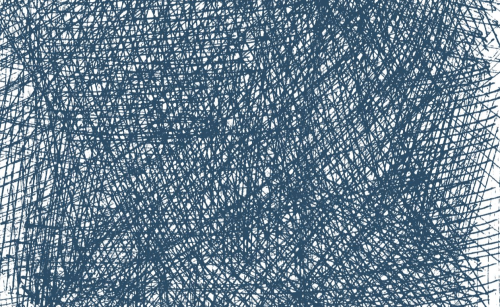Une Science sans conscience est un monde sans Progrès
J'enseigne à l'école CentraleSupelec où les profils des élèves sont similaires à ceux de l’institut Polytechnique. Actuellement une proportion croissante d’entre eux fait face à des difficultés financières. Il s’agit d’un fait assez nouveau dans les amphithéâtres des écoles d’ingénieur et il est de notre devoir de les aider. Ce phénomène est cependant révélateur d’une crise profonde de notre temps : il ne s’agit pas seulement de leur offrir une aide financière ponctuelle mais des perspectives, et de redonner un sens, une vocation peut-être à leur métier. En effet, si la portée du travail des ingénieurs n’est pas toujours mesurée à sa juste valeur, ces derniers représentent bien l’un des groupes clés pour l’avenir de nos sociétés. Et pour cause, ils sont amenés à repenser les outils dont nous nous servons au quotidien.
Dans notre société qui doute d’elle-même jusqu’à faire le déni de la science, quelle place doit jouer l’ingénieur et plus largement le scientifique ? Cette question capitale se pose également dans le cadre de la crise démocratique que nous traversons et se trouve être en lien avec le thème du numéro de cette revue. En effet, nous ne pouvons pas aborder les rapports entre le numérique et la démocratie sans réfléchir plus largement aux champs et fonctions respectives de la (techno)-science et de l’ingénieur.
Répondre à cette interrogation devient urgent alors que les étudiants se questionnent davantage que leurs aînés quant à la direction à donner au métier d’ingénieur comme j’ai pu le constater à travers les copies que je corrige chaque année dans mon cours de philosophie de la physique.
Et de toute évidence, le climat actuel les perturbe. La plupart d’entre eux est sujette à l’eco-anxiété, tandis que certains en arrivent même à être technophobes… un comble pour des ingénieurs…
C’est pourquoi, il semble important de pouvoir fabriquer à nouveau un récit qui parle à chaque génération d’ingénieur et permette de répondre à deux questions fondamentales : quels sont les raisons et les objectifs associés au travail de l’ingénieur ?
Je vais tenter d’apporter ici des éclaircissements à ces problématiques à travers 5 points : science et confiance, l’engagement des ingénieurs dans le débat public, la nature évanescente et le caractère ludique des nouvelles technologies du quotidien, la substitution opérée entre innovation et Progrès, et enfin la nécessité de ressusciter l’idée de Progrès.
DANS QUELLE MESURE PEUT-ON FAIRE CONFIANCE À LA SCIENCE ?
Une étude réalisée par l’économiste Daniel Cohen, après 18 mois de pandémie en novembre 2021 a été conduite à l’échelle européenne selon 3 axes : la santé de l’économie, l’état psychique des populations après plusieurs mois de confinement, et la confiance dans la science. L’évolution de ces 3 facteurs fut suivie pays par pays. Toutefois, il subsiste un flou artistique au sujet de la dernière catégorie qu’il convient de dissiper car cette question peut être comprise au moins de 3 manières différentes :
-
Croyez-vous la parole des scientifiques ? Croyez-vous à leur discours ? Si oui les croyez-vous tous ou seulement certains en particulier ?
-
Avez-vous confiance dans la science en tant que démarche de connaissance pour produire des résultats objectifs que les autres démarches de connaissance ne pourraient produire ? Autrement, dit pensez-vous que la science est une voie qui révèle des connaissances auxquelles on ne pourrait accéder par aucun autre chemin ?
-
Avez-vous confiance dans la science pour relever, par le biais des technologies, les défis contemporains qui se posent aux sociétés humaines ? (changement climatique, protection de la biodiversité, pollutions diverses…)
La conclusion du rapport paraît à première vue étonnante : contrairement à ce qui est généralement admis, il n’y a aucune défiance contre la science, comme en témoigne la stabilité du taux de confiance estimé qui a oscillé autour de 90% au cours de la pandémie, à l’exception de la France où nous avons perdu 22 points pendant la durée de l’étude. Cette chute vertigineuse n’est-elle pas encore l’expression de notre fameuse « exception culturelle française » ? Cette singularité s’est certainement forgée à travers l’instrumentalisation politique avec sa théâtralité aboutissant à une mise en scène néfaste de la science et de la recherche pendant la pandémie de la Covid-19.
LE SILENCE DES INGÉNIEURS FRANÇAIS : UN PROBLÈME DE DÉMOCRATIE
Au cours de la crise sanitaire, nous avons collectionné avec mon laboratoire au CEA l’intégralité des publications de presse relatives au débat sur la 5G. A notre grande surprise, aucun n’article n’avait été écrit par des ingénieurs.
Pourtant le corps des ingénieurs ne manque pas de représentants au sein de la population française. Les ingénieurs sont bien prolixes au sein des entreprises et produisent une profusion de rapports. Cependant, ils sont les grands absents du débat public. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce constat ?
Dans une démocratie responsable et suffisamment mature, la société devrait pouvoir débattre du type de « compagnonnage » qu’elle souhaiterait établir avec les technologies, qu’il s’agisse des nouvelles formes d’énergie, de 5G, de l’IA… Par exemple, en matière d’IA nous devrions pouvoir débattre de manière experte, libre et franche sur les décisions que nous sommes prêts à déléguer à des machines.
Mais au contraire, lorsque ces problématiques sont portées dans la sphère publique des délibérations, on constate malheureusement une décorrélation quasi complète entre la compétence et la militance.
Par militance entendons le fait de prendre parti : être pour ou contre, pro ou anti.
Il semble ainsi que le fait d’avoir un avis tranché dédouane l’émetteur de devoir s’instruire au sujet de quoi il exprime une opinion. Cette réalité est parfaitement illustrée par la question des centrales nucléaires et de leur combustible : l’uranium. Prenez parmi vos amis ceux qui sont « anti-nucléaire » et demandez-leur pourquoi les particularités de l’uranium font qu’on ne peut pas le remplacer par de l’aluminium ou du krypton. Vous verrez que la plupart ne sauront pas répondre. Mais ils sont opposés au nucléaire ; et cela leur suffit pour légitimer leur point de vue. Le plus cocasse est que si vous répétez cette expérience avec les « pro-nucléaire » de votre entourage, vous arriverez très certainement au même résultat.
Ceci est la manifestation d’un mécanisme de perception sociale des technologies exhibé par l’épistémologue Gilbert Simondon : les technologies sont jugées à l’aune de leur « halo-symbolique ». Ainsi, une technologie porte en elle un halo symbolique qui détermine le jugement que nous exerçons sur elles, indépendamment de la connaissance objective et matérielle de ce que sont ces technologies. En l’occurrence, si nous revenons au cas de la 5G, tous les sondages d’opinion montraient que la proportion de français « sans opinion » avoisinait les 15%. Tout le monde avait donc un avis sans être capable de dire ce qu’est la 5G.
Cela semble le signal nécessaire (et suffisant !) pour inciter les ingénieurs à prendre enfin la parole afin qu’ils disent ce qu’ils font, ce qu’ils pensent, et ce qu’ils pensent de ce qu’ils font, sans quoi la militance va entraîner les débats dans des sophismes où toute argumentation finira par disparaître.
A l’académie des technologies, à laquelle j’appartiens, cette question est devenue centrale. Et c’est bien la fonction de l’académie puisque son rôle est de se saisir des sujets technologiques ou d’être saisie de problématiques. Mais son poids dans l’addition politique est inversement proportionnel à la longueur et la lourdeur du processus d’analyse de ces questions technologiques : audit d’experts sur plusieurs mois, discussions d’avis soumis à un vote, production de copieux rapports mis en ligne sur le site de l’institution… Nous pourrions nous satisfaire du résultat en nous disant « nous avons rudement bien travaillés ». Sauf que personne ne lit lesdits rapports et comme le dit le nouveau président de l’académie des technologies « cela ne peut pas durer » !
Ces avis découlant d’une expertise ont de la valeur. C’est pourquoi, les ingénieurs doivent porter leurs perspectives, car dans notre société, la valeur d’une valeur dépend du prix qu’un individu, un groupe ou une entité est désireuse de payer pour assurer sa défense. Sans engagement réel, sans prendre des coups ou s’exposer, cela revient à considérer que l’avis des mutiques ingénieurs n’a pas de valeur… Le combat contre « rhéteurs et beaux-parleurs professionnels » est certes risqué, car comme le disait Platon, avec un sophiste ont fait toujours au mieux match nul… Mais il est inévitable et nécessaire. Trop souvent les gens compétents sont modérés et cela contribue à étouffer leur voix. Il faut donc que cela cesse : les experts modérés doivent donc s’engager sans modération !
Sans quoi les positions extrêmes, idéologiques, cliveront toujours plus les débats et feront barrage à l’émergence d’avis faisant autorité.
TENSION ENTRE SCIENCE ET TECHNIQUE : LA NATURE DE LA TECHNOLOGIE CONTEMPORAINE
Notre société moderne occidentale est héritière des transformations philosophiques opérées au XVIIIe. Faisons ainsi un détour historique pour revenir sur le projet de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert qui contribua à développer diffuser les connaissances et faire de l’esprit de Raison un étalon. Si le projet originel consistait en une traduction en français de la Britannica, en la lisant, les Encyclopédistes réalisèrent que cette dernière rassemblait une somme considérable des connaissances de l’époque mais qu’elle ne parlait aucunement de technique que l’on dénomme technologie de nos jours. Le pari des philosophes des Lumières fut alors que la technique était vectrice de pédagogie scientifique. Autrement dit, ils postulèrent qu’en expliquant le fonctionnement des objets techniques familiers, les principes qui ont rendu ces objets possibles seraient implicitement connus par une majorité de la population : la technologie devenue familière diffuserait par son existence même de la connaissance scientifique. C’est pourquoi, cette fameuse société des gens de lettre ajouta cinq tomes volumineux à l’Encyclopédie initiale composés exclusivement de planches, de dessins et d’illustrations magnifiques. Ces véritables œuvres d’art expliquent le maniement des outils agricoles, dévoilent les secrets de fabrication du verre, le principe de fonctionnement de l’imprimerie, d’un télescope, les méthodes de construction d’une maison etc. …
Si ce postulat est contestable aujourd’hui, peut-être a-t-il été couronné de succès à certaines époques. Dans le roman L’immortalité Kundera explore le problème de la technique dans la vie quotidienne. Goethe auquel le célèbre écrivain tchèque y fait référence est l’image de cet honnête homme du XIXe, et du succès des idées des Lumières : le grand écrivain allemand avait une maîtrise complète des techniques de son temps en allant du gros œuvre jusqu’à disposer d’une capacité de discuter avec son médecin de tous les types d’opérations chirurgicales possibles qu’il pouvait subir.
Mais aujourd’hui c’est l’inverse qui se produit : plus un objet technique est complexe et plus il est facile de l’utiliser sans rien y comprendre.
L’un des exemples les plus frappants de ce fait à notre époque est celui des smartphones, qui nous sont vendus sans notice. Ainsi, ces objets sont devenus tellement conviviaux que nous n’avons nul besoin de comprendre leur fonctionnement pour les faire marcher. Comme le disait le futurologue Arthur Clarke, plus un objet technique est complexe et plus il nous semble proche de la magie.
De ce fait, la technologie nous éloigne de la science, au sens où elle rend la connaissance scientifique pratiquement inutile. Ou plutôt comme la connaissance scientifique est inutile en pratique, elle devient pratiquement inutile. Ce paradoxe démontre que la connaissance scientifique tend à devenir un luxe, un plaisir culturel ou intellectuel. L’enquête réalisée cette année auprès des élèves de 6e, révèle que seuls 22% des répondants furent capables de placer correctement la barre ½ sur une droite graduée. Les élèves perdus par cet exercice, pourtant élémentaire, ne sont pour autant aucunement gênés pour l’usage qu’ils font de leur téléphone portable connecté. La convivialité de la technologie contemporaine permet ainsi d’être nul en maths…
LA DÉFAITE DU CONCEPT DE PROGRÈS OU QUAND LA CERTITUDE TUE LA SCIENCE
Ces facilités grandissantes au quotidien, et plus encore chez les jeunes qui naissent quasiment avec un smartphone dans leurs mains, s’accompagnent d’un mal-être face à l’expérience de l’incertitude. Et ceci n’est pas étranger au malaise grandissant que la société ressent vis-à-vis de la science. Car si cette dernière produit des connaissances, elle est désormais également source d’une incertitude d’un type très particulier : comme la science n’est plus enchâssée dans l’idée de Progrès, elle ne nous dit pas ce que nous devons faire des potentialités technologiques qu’elle nous donne.
Par le passé, on explorait ces possibilités sur la base que la science était le moteur du Progrès. Puis on dressait ensuite le bilan à l’issue de ce processus. Mais, à notre époque, nous avons compris que cette stratégie ne fonctionne pas… A contrario, nous devons décider parmi les applications que la science permet, celles que nous souhaitons adopter et celles que nous refusons. Toutefois, l’organisation de débats permettant ces choix est épineuse et conduit bien souvent les organes de décision à procrastiner...
L’INNOVATION UNE PHILOSOPHIE DE L’IMMOBILISME ?
N’est-ce pas tenter de fuir la nécessité d’évoluer que de remettre les choses à demain ? Cette fuite en avant, est plutôt une fuite hors du temps. Le mot innovation, bien dans l’air du temps, se substitue à celui de Progrès. Son usage est désormais massif aussi bien dans le monde de l’entreprise que dans les organismes de recherche.
En feuilletant mes polycopiés de cours à Centrale Paris datant des années 1980, lorsque j’étais encore étudiant, j’ai pu constater que le mot innovation était absent. Avec mon collègue de l’Académie des technologies, le sociologue Gérald Bronner, cela nous a incité à mesurer la fréquence d’apparition du mot innovation dans les discours publics (i.e. les discours politiques, institutionnels, des campagnes présidentielles, etc. …). Nous avons ainsi découvert que le mot Progrès, fut d’abord orthographié pendant 3 siècles avec une majuscule soit tout au long d’une ère initiée par la philosophie des Lumières que nous qualifions classiquement en histoire d’époque de la modernité.
Le mot progrès perd ensuite sa majuscule après la première guerre mondiale et commence à décliner en popularité à la fin des années 1980, au moment où réapparait un très vieux terme de la langue française jusqu’alors complètement abandonné : le mot innovation. L’inversement de popularité entre ces deux noms se produit en 2003. Le mot progrès est enfin « liquidé » pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy (2007-2012). Ainsi si tous les candidats à l’élection présidentielle de 2007 l’utilisaient selon diverses acceptions, en 2012 plus aucun ne le revendique…
Comment se fait-il qu’un mot qui a structuré la modernité ait pu être délaissé en si peu de temps ?
On pourrait être de tenter de rétorquer à ce raisonnement qu’« innovation » est un synonyme plus moderne de « progrès ». Et qu’il ne s’agirait donc que d’une évolution naturelle de la langue… Mais ceci est une erreur !
Les rhétoriques dans lesquelles on place le mot innovation ne rendent donc pas justice à l’idée de Progrès. Et cette réalité tourmente le cerveau de nos jeunes ingénieurs.
Pour saisir le sens de cette préoccupation revenons à l’étymologie des deux termes.
Historiquement progresser était un mot à connotation spatiale. On disait « une armée progresse » ; cependant cela ne signifiait pas qu’elle perfectionnait son équipement. L’idée géniale des Lumières fut d’étendre ce que l’on disait à propos de l’espace au temps. Ainsi, pouvait-on avancer dans l’espace mais aussi dans le temps, c’est-à-dire s’améliorer, progresser de façon méliorative au cours du temps.
Pour y parvenir, cela suppose un travail intellectuel : configurer le futur à l’avance d’une façon crédible et attractive. Crédible car il ne s’agit pas de penser un autre monde de manière utopique sans dire comment on peut l’atteindre. Et c’est la science qui remplit cette fonction, celle de donner de la crédibilité au projet. Pour les adolescents de ma génération cet état d’esprit semblait aller de soi : dans les magazines que nous lisions, les Tintin, Spirou, etc. …, on nous parlait chaque semaine de l’an 2000 qui était ainsi configuré. Il était même représenté dans les 2 sens du terme : mis dans notre présent et dessiné par le biais de bandes dessinées, illustrant un futur hypothétique avec ses modes de vie, de travail, de transport. Le futur était mis là, devant nous. Symboliquement, chacun avait le choix de sa trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et le futur qui était représenté.
Mais aujourd’hui cet horizon projectif a disparu. On ne parle plus de 2050. Personne ne fait l’effort de dessiner 2050 ou 2100 : le futur est laissé en jachère intellectuelle. Cette incapacité à penser le monde de demain est encore plus difficile à vivre pour nos jeunes qu’ils soient ingénieurs ou non…
L’attractivité est constitutive de l’idée de Progrès et c’est probablement la raison explicitant toutes les peines que nous avons aujourd’hui à construire un horizon temporel. En effet, le Progrès n’est pas automatique. Il suppose d’accepter des sacrifices pour que les générations futures vivent mieux que la nôtre. C’est ce qu’explique Kant dans son petit traité Qu’est-ce que les Lumières : « l’idée de Progrès est doublement consonante et sacrificielle ». Croire au Progrès c’est donc accepter de sacrifier du présent personnel au nom d’un futur collectif, ce qui suppose une philosophie de l’Histoire dont ne nous disposons plus. Après le passage de l’an 2000 nous avons jusqu’à présent échoué à fabriquer un horizon projectif pour 2100 qui soit à la fois crédible et attractif.
Le futur est laissé en lévitation politique : une situation inacceptable pour un ingénieur qui a besoin de se projeter. Car c’est cette projection qui donne un sens au travail !
Ainsi, croire au Progrès c’est considérer que le temps qui passe est constructeur et complice de notre liberté et de notre volonté. Mais il ne s’agit pas non plus de se bercer d’illusions : adopter la philosophie du Progrès c’est accepter la part de risques, d’incertitudes et d’échecs qui l’accompagnent même ponctuellement. La réaction de la presse française après le premier grand accident de train en 1842, ayant déraillé entre Versailles et Bagnes illustre parfaitement cet élan nécessaire au Progrès : aux critiques remettant en cause le concept de voyage en chemin de fer sur la base qu’il présentait visiblement des dangers et l’inconvénient d’être plus lent que le cheval, se succédèrent très rapidement l’idée que le combat pour la civilisation suppose d’embrasser les risques et les échecs associés. Alphonse de Lamartine, alors député conclut un célèbre discours à la tribune de la chambre de chemin de fer au son de « craignons-les, plaignons-nous mais marchons ». Il est impossible d’imaginer un homme politique contemporain prononcer de telles paroles après un accident mortel. Ce que cela démontre c’est que notre rapport au risque, que suppose l’idée de Progrès, a complètement changé en deux siècles.
Avec le philosophe Vincent Bontems, nous avons enfin cherché à retracer l’histoire du mot innovation pour comprendre les raisons de la réapparition d’un terme tombé en désuétude.
Il apparait ainsi en France au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique. L’innovation dénommait alors ce que l’on appelle aujourd’hui avenant à un contrat. Et cette acception est éloquente pour comprendre la signification du mot innovation. Un avenant est un acte juridique qui se traduit par la rédaction d’une clause additionnelle permettant de modifier sous certaines conditions un contrat afin qu’il demeure valide. Ainsi, l’innovation est « ce qu’il faut faire pour que cela ne change pas ».
Le mot circule ensuite dans d’autres sphères et on le retrouve en politique dans le Prince de Machiavel qui préconise que lorsque le souverain détient le pouvoir il ne doit aucunement innover sauf si son pouvoir est menacé.
L’innovation est donc un principe de conservation : c’est ce qu’il faut faire pour conserver quelque chose.
Enfin, le premier à associer innovation et technique est l’anglais Francis Bacon en 1632 dans son essai Conseils civils et moraux, où il y consacre un chapitre éponyme. Certaines années je m’amuse à soumettre ce passage sur l’innovation à mes élèves centraliens sans leur indiquer l’identité de l’auteur ni l’époque à laquelle il a été rédigé. Puis je leur demande de deviner qui est l’écrivain à l’origine du texte. Un premier groupe lève la main pour l’attribuer à Alain Minc, un deuxième à Jacques Attali ou un troisième enfin à Bruno Lemaire…
Cela révèle la modernité de ce texte du XVIIe similaire à s’y méprendre à un texte contemporain.
Dans cet extrait Francis Bacon affirme que le temps qui passe est corrupteur : il dégrade les situations. Ainsi, face à des défis toujours plus complexes à relever, le philosophe anglais recommande l’innovation technique pour contrer cette détérioration. Il préconise même d’adopter une cadence équilibrée de déploiement des innovations, c’est-à-dire au rythme du temps pour garantir leur acceptation par le peuple et maintenir le monde en l’état.
Près de quatre siècles plus tard, un texte doctrinaire de la commission européenne datant de 2010 plagie Francis Bacon: « L’Europe a compris qu’elle est devant des défis dont la gravité augmente avec le temps qui passe ». Elle y proclame devenir l’Union de l’innovation. En 52 pages, le mot innovation est cité 307 fois sans être nulle part défini.
L’INNOVATION N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS !
Autrement dit, l’innovation n’est pas configurée par une certaine image du futur, rêvée à l’avance en pensée, et que l’on souhaiterait atteindre mais par l’état critique du présent.
J’ose affirmer qu’il s’agit d’un message mortifère qui est communiqué à nos jeunes ingénieurs. Car on leur inculque que seule l’innovation représente le salut en évacuant l’idée même de désir, c’est-à-dire d’un avenir désirable entendu comme Progrès.
Au contraire, l’ingénieur, croyant le plus souvent au Progrès doit soumettre l’idée de Progrès à elle-même, c’est-à-dire la faire progresser.
Il devient vital de revendiquer le mot Progrès et son concept associé plutôt que de l’annihiler au profit d’un mot – innovation – qui le trahit, en l’insérant dans une rhétorique qui démontre que l’on a réfléchit à ce qu’il doit être.
Si les philosophes des Lumières à la manière de Condorcet qui croyait au passage successif des différentes formes de progrès selon un embrayage automatique ou de D’Alembert qui affirmait dans son article « géomètre » que former des mathématiciens au sein d’une nation tyrannique permettrait au peuple de se libérer de son joug, ont développé des préceptes empreints de naïveté, supposant qu’en toutes circonstances le bien et le mal étaient distinguables, il importe de retenir de leur posture que croire au Progrès c’est penser que le négatif est relatif.
Ainsi, ce qui ne va pas dans une société, une entreprise, une nation, une personne, un objet technique n’est pas condamné irrémédiablement à aller mal. Au contraire, le négatif est le ferment du meilleur !
Si le Progrès suppose effectivement une capacité à dénouer le bien du mal, il faut se garder d’avoir une représentation trop arrêtée de ce qu’est le bien au risque de commettre le mal. L’histoire nous a appris que les bien-pensants qui pensent avoir une vision précise de ce qu’est le bien ont tendance à faire le mal sans aucune culpabilité.
Il faut donc régénérer la notion de Progrès en tenant compte des enseignements de l’Histoire pour que le travail, la mission, et l’activité des ingénieurs soient davantage capable de dire publiquement ce pour quoi ils travaillent.